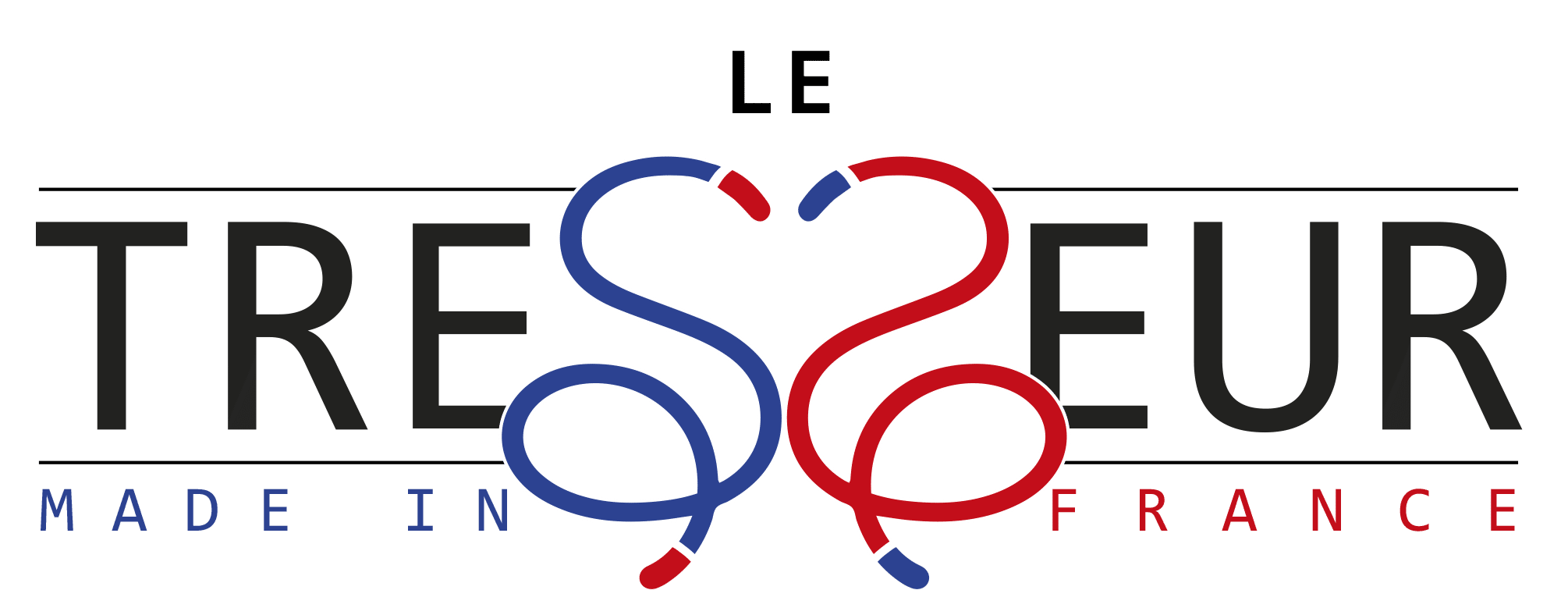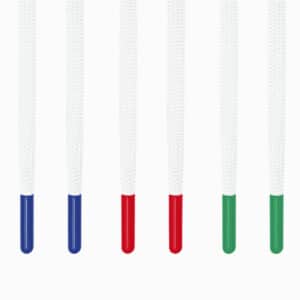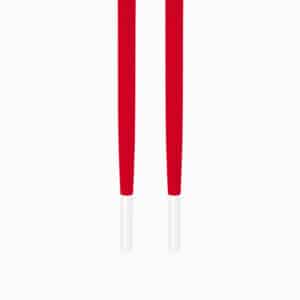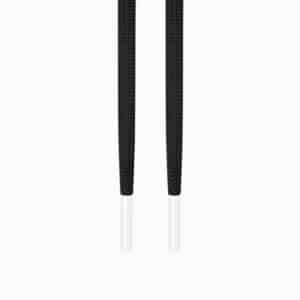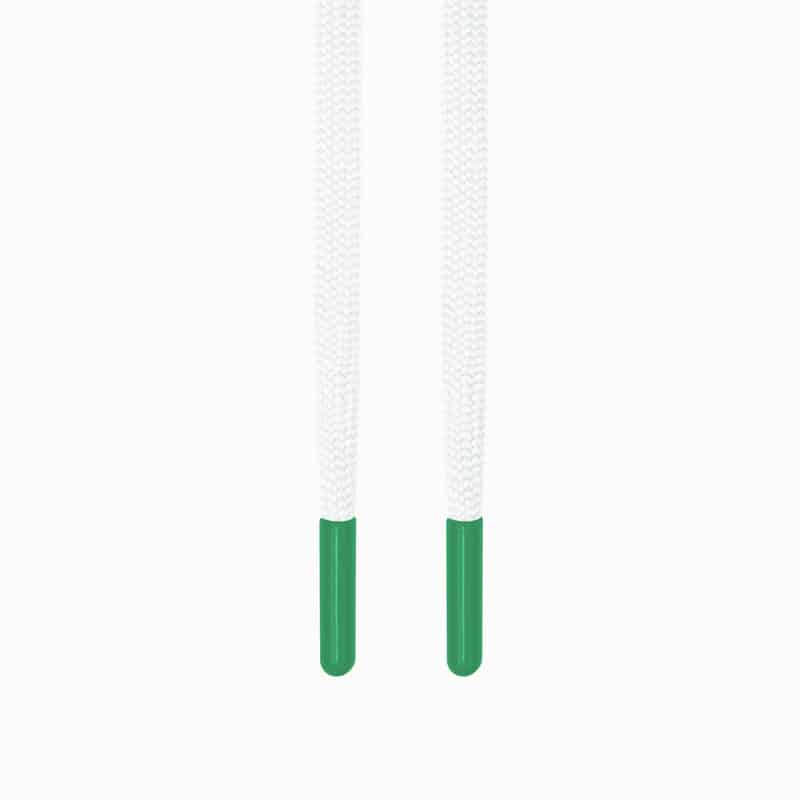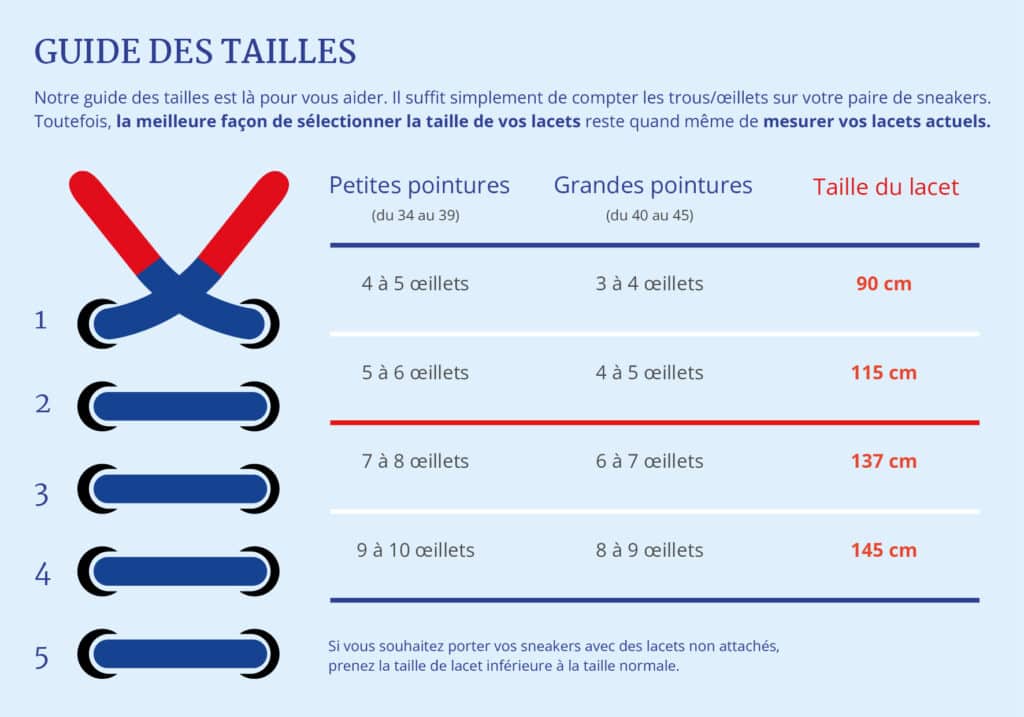UNE SAGA DE TRESSEURS AUVERGNATS : ÉPISODE 2 - CLAUDE OMERIN
Claude Omerin et quelques ouvrières de l’atelier de perles à chapelets d’Escalon
TEMPS DE LECTURE
5 minutes
Thibault Omerin, fondateur du Tresseur, dont vous connaissez les lacets colorés et personnalisables, est né dans une famille de tresseurs, forte de six générations successives dans le domaine.
Outre le savoir-faire qui se transmet au fil des générations, c’est surtout une épopée d’entrepreneurs différents, s’inscrivant dans des périodes particulières, marquées par le contexte économique de l’époque. C’est ce que nous vous proposons de découvrir au cours de cette « série » consacrée à chacun des membres de la saga.
Dans ce deuxième épisode nous retrouvons Claude Omerin et son épouse Joséphine : Les Transmetteurs !
Claude Omerin (1878-1953) et Joséphine : Les Transmetteurs
Raconter l’histoire d’une dynastie d’industriels c’est aussi tenir compte de la personnalité de chacun, ses points forts et ses faiblesses.
Claude Omerin n’a pas la volonté entrepreneuriale de son père, ni sa force. Mais il a l’esprit vif et acquiert dans ses jeunes années un vrai talent de mécanicien qu’il apportera à l’entreprise durant toute sa carrière.
Suivant les activités de son père, il nait les mains dans la farine, avant d’apprendre, adolescent et jeune adulte, à guillocher et polir les perles de chapelets à Ambert. Puis en 1906 à débuter lui aussi un nouveau métier de tresseur à Job.
Deux ans plus tard, il épouse Joséphine Poutignat de Bertignat de 10 ans sa cadette, qui sera non seulement sa femme et la mère de leur fils unique Jacques, né en 1909, mais son soutien quotidien à l’usine dans les taches de production et de suivi des ouvrières.

Joséphine et son fils Jacques en 1914
Guerres et entre-deux guerres
Claude a 36 ans quand débute la première guerre mondiale. Il est donc tout à fait en âge d’être mobilisé. Son livret militaire nous en dit plus sur cette période. Après avoir fait son service militaire durant 2 ans en 1900, il est appelé en 1914 à rejoindre les drapeaux. Paradoxalement, c’est sans doute sa santé fragile qui va lui sauver la vie. En effet, il est presque immédiatement réformé pour « épilepsie ». Mais en 1915, l’armée ayant besoin de bras, on l’appelle à nouveau… mais cette fois très à l’arrière du front, où ses qualités de mécanicien seront exploitées par la patrie. Ainsi sera-t-il affecté à la Société des Aciéries de France à Aubin (Aveyron), à l’arsenal de Toulouse, à Carmaux et pour finir à Clermont-Ferrand. Il sera libéré de ses obligations militaires en février 1919. Il a 41 ans.
C’est le moment pour lui de revenir prendre les rênes de l’usine familiale. Mais son vieux père ne l’entend pas de cette oreille et n’a pas la volonté de lâcher l’affaire. En février 1926, Jacques, alors âgé de 82 ans, annonce à l’Union syndicale des fabricants de tresses qu’il compte transmettre sa société à son fils dans « un ou deux ans » !
L’été de cette même année, Claude, secondé par son jeune fils Jacques, poussera néanmoins son père à prendre une retraite plus que méritée. Le vieux Jacques décédera deux ans plus tard.

Claude en train d’usiner du bois (1905)
De crises en crises
C’est donc un nouveau trio qui va se partager le travail de direction de l’usine, le père aux bâtiments et aux machines, la mère à la production et le jeune fils aux courriers, à l’administratif et au commerce.
Les courriers professionnels conservés par la famille nous retracent une période particulièrement difficile, jalonnée non seulement par les guerres et les crises économiques qui en résultent à long terme mais aussi par la chute des prix des produits manufacturés, la qualité médiocre des matières premières, les aléas climatiques (l’énergie étant uniquement hydraulique, le gel ou les sécheresses peuvent mettre l’usine à l’arrêt).
Claude n’a donc de cesse que de se battre avec ses fournisseurs – qui sont d’ailleurs aussi souvent ses clients – pour faire respecter les prix et les délais de livraison.
Dans la même période, l’industrie du lacet évolue et se tourne vers des produits plats ou colorés (déjà !) et plus seulement du lacet noir et rond. Claude est aussi l’homme de la situation pour régler ses métiers afin de produire de la « serpentine », ce petit galon plat et coloré en forme de vagues qui sert de décoration au linge de table ou aux robes des petites filles.

Claude Omerin durant la Seconde Guerre Mondiale
Tenir coûte que coûte
Aux périodes de vaches maigres succèdent des embellies, mais celles-ci sont de courte durée. Ainsi, par exemple, après la crise du début des années trente, puis les difficultés engendrées par le Front Populaire, l’industrie de la tresse semble aller vers des jours meilleurs. C’est sans compter sur les velléités guerrières de l’Allemagne et la mobilisation de Jacques en 1939. Tenue tant bien que mal par Claude et Joséphine (62 et 52 ans en 1940), ainsi que par leur belle-fille Marguerite, l’usine devra une nouvelle fois fermer en 1942 jusqu’au retour de captivité de Jacques.
Claude s’éteint en 1953, à l’âge de 75 ans, en ayant passé sa vie les mains dans les machines et surtout en ayant eu la capacité, avec son épouse Joséphine, de transmettre à Jacques ce qu’ils avaient reçu d’un autre Jacques.

Claude et Joséphine en 1939, au côté de Gabriel (leur petit-fils), Marguerite (leur belle-fille) et Marie-Claude (leur petite fille)
Contexte
La première moitié du XXe siècle sera celle des crises et des guerres. La Belle Époque n’aura été que de courte durée. Conséquences immédiates dans les usines lors de la première guerre mondiale : difficultés d’approvisionnement, chutes des ventes de ce qui n’est pas une « production de guerre », ralentissement des transports et surtout départ des hommes mobilisés. L’industrie de la tresse est pour sa part essentiellement féminine et ne ressentira pas le même « remplacement » que dans des usines plus masculines. Toutefois le départ des hommes au front et le nombre très important de veuves qui en résultera aura forcément un impact sur la mobilisation des femmes tant dans leur vie professionnelle, que dans leurs foyers ou dans les fermes qu’il faut continuer d’exploiter en l’absence des hommes. La saignée de la guerre dans les campagnes auvergnates diminuera sévèrement le nombre d’habitants et par conséquent la main-d’œuvre disponible.
Dans le Livradois, nombre des petites unités de tressage travaillent « à façon » pour des industries plus importantes à Ambert, Saint-Etienne et la vallée du Gier. Cela veut dire que l’atelier reçoit de son donneur d’ordre de la matière première – du fil pour le tressage – qu’il doit tresser et renvoyer à la même adresse sous forme de produit fini. L’après-guerre change les process : les grosses unités abandonnent petit à petit le travail à façon pour l’internaliser chez eux. D’où une perte de clientèle et le besoin impératif de se diversifier (tant en matière de clientèle que de produits). Autre inconvénient du travail à façon : les négociations de prix sont plus compliquées quand le donneur d’ordre est à la fois fournisseur et client, surtout s’il a tendance à augmenter le prix des matières premières envoyées et diminuer celui des produits finis reçus !